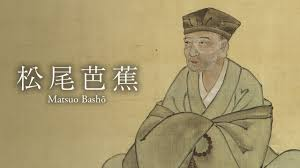RYTHMES ET CADENCES DE LA VIE MODERNE :
QUEL TEMPS POUR SOI ?
Chaplin en chanson (4 mn)
Un jour, un destin : Charlie Chaplin la légende du siècle (1h55)
Film Les temps modernes (1936)
- C'est quoi le TAYLORISME et le FORDISME ?
- Le travail à la chaîne a 100 ans (Europe 1, 2 mn)
- Usine : travaille et tais-toi (4 mn)
- Le fordisme (5 mn et 1 mn)
Salvador Dali : La persistance de la mémoire,
1931, huile sur toile, 33X24.1cm, The Museum of Modern Art, New York.

La paranoïa-critique au service de La Persistance de la mémoire
Le ciel crépusculaire de La Persistance de la mémoire est celui d’une plage des alentours de Portlligat, au nord de la Catalogne natale de Salvador Dalí. L’idée de la toile lui vient alors que Gala et des amis sont de sortie au cinéma. Dalí se retrouve seul au milieu d’une cuisine étrangement silencieuse. Son regard se pose soudain sur un camembert, seul lui aussi, au centre de son assiette. Il est mou. Il coule. L’artiste laisse alors son esprit divaguer et a recours à une technique de sa propre création : la paranoïa-critique.
Celle-ci se construit en deux étapes diamétralement opposées. Dans un premier temps, Dalí fantasme et autorise ses pensées les plus délirantes à se manifester pour, dans un second temps, les objectifier. Alors, le fromage coulant se transforme en montres à gousset dégoulinantes. Elles témoignent de la fascination de l’artiste pour la temporalité. Dalí peint ses montres par-dessus le paysage qui n’attendait plus qu’elles. La Persistance de la mémoire est née.

Que symbolise La Persistance de la mémoire de Salvador Dalí ?
La Persistance de la mémoire de Salvador Dalí plonge le spectateur dans un univers onirique et définitivement étrange où surfaces dures et molles se partagent l’affiche. L’œuvre est déconcertante car elle oppose le surréalisme au réel. Elle questionne le caractère inéluctable du temps et concrétise l’obsession de l’artiste pour sa symbolique. Sommes-nous à sa merci ? Une chose est sûre, le temps passe mais laisse derrière lui des souvenirs ; la mémoire persiste. Le tableau peut être décomposé en différents éléments, numérotés dans l’image ci-dessus.
- Les montres molles symbolisent le temps, qui est relatif, en mouvement. Comme dans nos rêves, passé, présent et futur cohabitent et fonctionnent en synergie. Chacune posée sur une surface différente, elles représentent ces trois temporalités.
- La montre orange ne fond pas. Elle fait écho au temps qui passe, alors qu’elle est retournée et recouverte par des fourmis.
- Les fourmis envahissent la montre solide et symbolisent la décomposition, la mort. Le peintre fait ce rapprochement enfant lorsqu’il observe des fourmis grouiller sur le cadavre d’une chauve-souris.
- La mouche symbolise le temps qui s’envole et qui passe.
- Le drôle d’objet ou le personnage qui gît par terre pourrait représenter le peintre ou le monde intérieur et son onirisme.
- Le miroir incarne l’inconstance. Il reflète la réalité tout comme l’imaginaire.
- L’olivier, symbole de sagesse, est sec, mort. C’est un signe du passé.
- La plage est déserte et le sol semble dur. La rive représente le vide émotionnel que ressent le peintre.
- La mer lumineuse symbolise la mémoire et le monde réel, immuable. Elle contraste avec le premier plan sombre qui fait écho à un monde imaginaire et accablant.
- Les montagnes sont ancrées dans le sol comme dans le passé. Elles composent le paysage de l’enfance du peintre catalan.
- L’œuf est synonyme de naissance et donc de renouveau.
Avant même de commencer le tournage, il a été nécessaire d'inventer des outils sur mesure pour filmer les « personnages » du film, les insectes, comme sont filmés les acteurs dans les films de fiction : pouvoir accompagner leurs actions avec des travellings, mouvements de grue et autres panoramiques, de façon à leur donner la stature de véritables protagonistes. Après deux ans d'efforts, un « motion control » (robot commandant à distance tous les mouvements de caméra) a pu être opérationnel, grâce au spécialiste des moteurs pas à pas Romano Prada. C'est une grosse caméra 35 mm guidée du bout des doigts avec une précision au dixième de millimètre et sans vibrations. Cette machine de 300 kilos fut accrochée au plafond en béton du studio de prises de vues, construit spécialement pour le film dans un petit village du Causse Comtal, au-dessus d'une prairie reconstituée. Plus des trois quarts du film ont été ainsi filmés en studio, mais un studio situé en plein champ dans une prairie de l'Aveyron. Presque chaque scène du film est un mélange de plans tournés en extérieur, tout autour du studio et de plans effectués à l'aide du « motion control »3.
L'univers sonore du film est un mélange entre des sons réels, captés sur le terrain avec des microphones spéciaux, et des sons créés par le « sound designer » et monteur son Laurent Quaglio, lors du montage du film. Les bruits d'insectes les plus faibles ou les plus difficiles à capter ont été enregistrés individuellement dans une chambre anéchoïque de l'INRA puis retravaillés. Après discussion avec les réalisateurs. Bruno Coulais, compositeur de la musique, a travaillé en concertation étroite avec le monteur son de telle sorte que, souvent, on ne sait pas si les sons entendus sont dus à des instruments de musique ou aux insectes3.
Microcosmos a nécessité deux ans d'écriture pour le scénario, deux ans de préparation, trois ans de tournage et neuf mois de montage et mixage.
La critique Télérama
Genre : promenade bucolique.
Des chenilles cherchent où faire leur mue. Une araignée collecte des bulles d'air à la surface d'un étang pour construire sa « cloche à plongeur »... Quand les deux scientifiques-cinéastes Claude Nuridsany et Marie Pérennou se penchent sur « le petit peuple de l'herbe », on débarque sur une planète inconnue, peuplée de créatures étranges. Jamais l'aventure quotidienne de ces « personnages » n'avait été filmée ainsi : ni leçon de choses ni document scientifique, Microcosmos (un succès exceptionnel dans le monde entier) est d'abord une invitation au spectacle.
En supprimant tout commentaire, les auteurs font surgir une foule d'images venues d'ailleurs. C'est-à-dire... de tout près, dans le champ d'à côté. Ils n'expliquent pas, ils montrent. Mais ils ne se contentent pas d'enregistrer la réalité, ils la mettent en scène. Ils filment les insectes comme des acteurs. D'étonnants mouvements d'appareil collent aux personnages dans leurs déplacements les plus complexes, comme si un cadreur miniaturisé avait travaillé caméra à l'épaule. Epatant ! — Bernard Génin
Autres critiques : Dragonfly et ici
La beauté de la croissance lente d'une plante grace au timelapse :